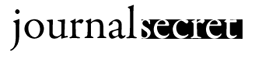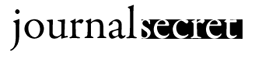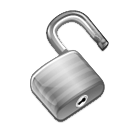
Journal public |
|
| |
la fête du travail  page publique page publique
Pour certains, il s’agit d’une journée de rassemblement pour revendiquer des droits fondamentaux. Pour d’autres, c’est un moment de repos bien mérité. Quoi qu'il en soit, le 1er mai se déroule aujourd’hui dans la joie et la bonne humeur. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Retour en arrière.
Belles journées de printemps, repos, instants de bonheur passés en famille ou entre amis sont souvent les premières idées qui viennent à l’esprit lorsqu’on évoque le 1er mai. Pourtant, les origines de cette journée où l'on "fête le travail" n’ont rien de plaisant et font même partie des instants les plus tragiques de l’Histoire.
À la fin du XIXe siècle, alors que la révolution industrielle rend les cadences de travail de plus en plus difficiles, les grèves et les manifestations ouvrières se multiplient. On revendique haut et fort de nouveaux droits pour les travailleurs. Le 1er mai 1886, une forte pression syndicale aux États-Unis permet à environ deux cent mille salariés d’obtenir la journée de huit heures. Des centaines de milliers d’autres travailleurs, moins chanceux, entament une grève illimitée. Le 3 mai, une grande manifestation fait trois morts parmi les grévistes de la société MC Cor Mick Harvester à Chicago à la suite de violents affrontements avec les forces de l’ordre.
La France n’est pas non plus épargnée par les tragédies. En 1891, également au cours du 1er mai, une manifestation pacifique se rend en cortège à la mairie de la ville de Fourmies. La troupe chargée d’assurer la sécurité se met à tirer à bout portant sur la foule. Parmi les morts, huit victimes ont moins de vingt et un ans. Avec ce nouveau drame, le 1er mai devient peu à peu une journée emblématique de la lutte ouvrière.
C’est en 1941 que le 1er mai devient la Fête du Travail
Mais malgré ces répressions sanglantes, la mobilisation ne faiblit pas. À l’initiative de la CGT, une importante manifestation a lieu le 1er mai 1906 pour réclamer la journée de 8 heures pour tous les travailleurs.
L’année 1936 prend également une signification tout à fait particulière car les mobilisations du 1er mai tombent deux jours avant les élections législatives qui vont porter le Front Populaire au pouvoir. Les accords qui légalisent les quarante heures de travail sont signés quelques semaines plus tard. La plus grande manifestation de l’histoire de France aura lieu le 1er mai de l’année suivante.
C’est en 1941 que ce jour devient officiellement la Fête du Travail et de la Concorde Sociale.
Six ans plus tard, sur proposition du député socialiste Daniel Mayer et avec l’accord du ministre du Travail Ambroise Croizat, le 1er mai devient une journée chômée et payée dans toutes les entreprises françaises.
Plus tard encore, entre 1954 et 1968, les revendications de la Fête du Travail se feront nettement moins entendre. Pendant la guerre d’Algérie, les manifestations seront totalement interdites dans Paris. Il faudra attendre 1968 pour retrouver les immenses cortèges des années trente.
Aujourd’hui, il semble difficile de savoir si le 1er mai est plutôt synonyme de repos ou de lutte. Pour Elyane Bressol, secrétaire général de l’Institut CGT d’Histoire Sociale, "La notion de lutte sociale restera toujours rattachée à cette journée particulière", même si les gens n’y participent pas forcément. "Les raisons qui rendent cette journée importante ne sont pratiquement plus évoquées par les médias", poursuit-elle. "Cela ne contribue pas à promouvoir le sens profond du 1er mai. Mais, on se rend bien compte que, lorsque les événements le demandent, les esprits solidaires resurgissent pour défendre des valeurs primordiales. Le 21 avril 2002 a été une date traumatisante pour l’Histoire de France. Quelques jours plus tard, le nombre de manifestants lors du 1er mai a été le plus important de ces vingt dernières années."
|